Cette semaine, la ville de Roubaix accueillait les ROUMICS (Rencontres OUvertes du Multimédia et de l’Internet Citoyen et Solidaire) consacrées cette année à une thématique particulièrement intéressante : « Vivre des Communs ». Bien que n’ayant pu participer à cet événement, je voulais par ce billet contribuer à la réflexion collective, en m’aventurant sur le terrain des liens entre le travail et les Communs. Un coup d’oeil au programme de ces journées à Roubaix montre que les différentes interventions et tables-rondes reflètent des discussions d’ordre économique et social qui reviennent de plus en plus fréquemment parmi les acteurs des Communs (« Vivre des Communs, comment ? », « Ils vivent de la contribution !? », « Rétribuer des contributeurs », etc.).

A dire vrai, il y a longtemps que la question des modèles économiques à développer pour garantir la soutenabilité des Communs se pose et une multitude de propositions ont été avancées pour penser des articulations avec le marché. Mais c’est une piste d’une autre nature que je voudrais explorer dans ce billet : celle de la reconnaissance d’un « droit social à la contribution », en m’appuyant notamment sur certains passages du dernier ouvrage publié en mars par les Économistes Atterrés (Changer d’avenir : réinventer le travail et le modèle économique).

Ce livre contient plusieurs références aux Communs, mobilisés par exemple pour renouveler l’approche des services publics ou encore celle de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Mais il comporte d’autres propositions originales, qui établissent un lien entre la réforme du système de protection sociale et les Communs. Les Économistes Atterrés reprennent à cet endroit certaines idées émises à la fin des années 1990 par le juriste Alain Supiot (professeur au collège de France et spécialiste des questions de droit social). Il me semble que ces thèses n’ont pas reçu encore toute l’attention qu’elles méritent, alors qu’elles permettent d’envisager la reconnaissance d’une forme de « droit au travail dans les Communs », qui fait directement écho à la thématique des ROUMICS de cette année.
Une relecture des « droits de tirage sociaux » d’Alain Supiot
Pour comprendre l’originalité des propositions des Économistes Attérés, il faut présenter brièvement les idées du juriste Alain Supiot dont elles s’inspirent (voir ici notamment pour un aperçu). Alors que notre système de protection sociale – héritier du compromis social ayant accompagné le développement du fordisme – est encore essentiellement basé sur l’emploi et le travail salarié, Alain Supiot propose d’instaurer un « droit commun du travail » qui étendrait le bénéfice des droits sociaux à l’ensemble des travailleurs, qu’ils soient salariés ou non. Le principal intérêt des thèses d’Alain Supiot est d’élargir le concept même de « travail », en le distinguant nettement de l’emploi auquel le sens commun tend pourtant à l’assimiler. Dans cette perspective, la protection sociale devrait être refondue à partir d’un « tronc commun » de droits fondamentaux dont bénéficierait la personne indépendamment de son statut professionnel (c’est-à-dire qu’elle soit salariée, travailleur indépendant ou encore au chômage). Mieux encore, Alain Supiot propose une extension de la notion de travail destinée à englober toute une série d’activités non-marchandes considérées comme socialement utiles : la formation des individus tout au long de la vie, le fait d’élever des enfants ou de prendre soin de personnes âgées ou de malades, le travail bénévole accompli par les individus à travers leurs engagements associatifs ou citoyens.
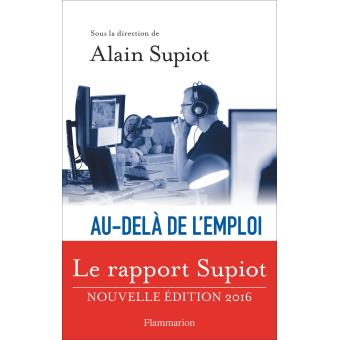
Prenant acte du fait que les individus – souvent par contrainte, mais aussi parfois par choix – naviguent au cours de leur vie entre ces différentes formes de « travail », Alain Supiot propose l’instauration de nouveaux droits sociaux « rechargeables », dont les individus seraient crédités tout au long de leur vie professionnelle :
un système de « droits de tirage sociaux« , provisionnés par des moyens divers (financement public, Sécurité sociale, employeur, de comptes d’épargne, etc.) qui permettent au salarié d’exercer sa liberté de se former, d’entreprendre, de se consacrer à sa vie de famille ou à une activité désintéressée, tout en étant assuré de retrouver ensuite sa place sur le marché du travail.
En fonction de leurs besoins, les personnes pourraient choisir d' »activer » ces droits, afin de mieux faire face aux changements subis d’activités ou pour les aider au contraire à en changer volontairement. La sécurité sociale traditionnelle, celle qui sert à couvrir les risques que les individus subissent passivement, serait ainsi complétée par une « sécurité sociale professionnelle » active (au sens d’activable). N’opérant plus de hiérarchie de valeurs entre emploi, travail indépendant et les formes de travail non-marchand, ce système aurait pour finalité de mettre les individus en capacité de décider quels types d’activités ils souhaitent exercer au cours de leur vie (avec une approche qui fait fortement penser aux « capabilités » de l’économiste Amartya Sen).
Dans leur ouvrage, les Économistes Attérés reprennent à leur compte le coeur de ces propositions, mais ils reformulent les droits de tirage sociaux d’Alain Supiot en « Droits Communs du Travail » (DCT). L’idée est de permettre aux individus de mieux faire face au développement de la « zone grise de l’emploi », qui provoque une précarisation accélérée et ne cesse de se développer sous l’effet de phénomènes comme l’ubérisation. Mais les Économistes Attérés choisissent aussi à dessein de parler de « Droits Communs du Travail » pour faire un lien explicite avec la question des Communs. Leur propos consiste à affirmer que si la notion de travail doit s’étendre à l’ensemble des activités socialement utiles, alors il faut aussi y inclure la contribution aux Communs.
L’élargissement aux « Droits Communs du Travail »
Les Droits Communs du Travail, tels qu’envisagés par les Économistes Atterrés, comprennent par exemple un droit renforcé à la formation, conçu comme un droit fondamental que les personnes pourraient activer périodiquement sans que leur employeur puisse s’y opposer. Mais ils pourraient aussi comporter des droits plus originaux comme « […] le droit à l’accès à du revenu pour des activités non salariées, mais reconnues d’utilité sociale, à du crédit et à des avances monétaires nécessaires au lancement d’activités nouvelles« . On doit comprendre qu’un employé ou un travailleur indépendant pourraient se voir crédités de ce type de droits en exerçant leur activité professionnelle et choisir à un moment donné de mobiliser leurs droits de tirage sociaux pour décider de se consacrer à des formes de travail non-marchand d’utilité sociale. Et symétriquement, l’accomplissement de telles activités non-marchandes créditeraient aussi des droits sociaux, mobilisables à leur tour pour faciliter un retour à l’emploi ou à l’entreprenariat
Le lien avec les Communs devient alors évident, car ces Droits Communs du Travail instaurent ce qu’on pourrait appeler « un droit au travail dans les Communs », comme cela apparaît par exemple dans ce passage :
[…] ces droits, en venant compléter ou conforter les droits sociaux existants, doivent porter sur des domaines multiples. Ils doivent être mis au service du renforcement du lien social à travers l’encouragement à des activités d’utilité sociale reconnue (crèches, aide aux personnes en difficulté, soutien scolaire, constitution de bases de données de toute nature – images, musique, texte – en accès ouvert venant compléter ou développer les bibliothèques municipales)
[…] Nombre d’activités développées comme des « communs » et délivrées en général à titre largement gratuit pourraient aussi – dans le cadre de ces droits communs du travail – voir leurs initiateurs bénéficier de différents types de droits nouveaux.
Un peu plus loin, un lien est également établi entre ces droits communs du travail et le développement des Communs urbains au niveau local :
[…] nombre de « communs urbains » […] couvrant des domaines aussi variés que la constitution et l’entretien de jardins ou de vergers partagés, l’isolation thermique et les dispositifs collectifs d’économies d’énergie au niveau des groupes d’habitation, la réfection de friches industrielles pour en faire des lieux d’accueil où dispenser des cours du soir et/ou d’alphabétisation, des salles de spectacles et d’exposition, etc. pourraient trouver ici des sources de financement à partir de dotations des municipalités au regard des services rendus. Dans le même esprit, ces activités dont l’utilité serait socialement reconnue et validée pourraient donner lieu à l’octroi de DCT (Droits Communs du Travail) au bénéfice des initiateurs et porteurs de ces droits nouveaux. Nombre de « communs » et d’entreprises coopératives « hybrides », car associant les collectivités locales et territoriales, pourraient ainsi trouver des moyens stables d’existence à long terme à partir des droits communs du travail attribués aux commoners qui animent ces activités, ou sous la forme de financement direct de ces activités elles-mêmes. La validation sociale dans ce cas doit passer par un système non-marchand, une assemblée démocratique d’acteurs locaux par exemple, constituée d’élus, de représentants, d’associations de consommateurs et d’habitants et promoteurs de nouveaux services sur le territoire.
On voit ici le potentiel que cette approche par les Droits Communs du travail pourrait avoir au niveau local et le lien éventuel avec les « Assemblées des Communs » ou « Fabriques des Communs » qui commencent à se développer de manière informelle dans plusieurs villes françaises (Lille, Lyon, Toulouse, Grenoble, Rennes, etc.).
Du droit à la contribution au revenu contributif ?
Les propositions des Économistes Attérés en rappellent d’autres, qui ont déjà été émises par le passé pour servir des buts similaires et qu’il est intéressant de comparer entre elles pour en souligner les nuances.
En 2014, un rapport consacré à la « transformation numérique de l’économie française » remis au gouvernement par Philippe Lemoine avait par exemple préconisé la création d’un « Droit Individuel à la Contribution (DIC) », conçu sur le modèle du Droit Individuel à la Formation (DIF) :
Créer le DIC (Droit Individuel à la Contribution), pour permettre aux salariés de consacrer du temps à des projets Open, par exemple en transformant du Droit Individuel à la Formation (DIF) en DIC.
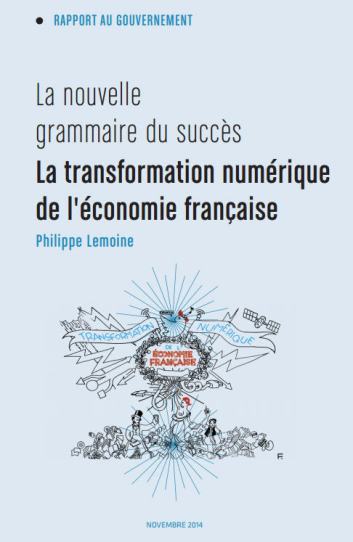
Cette proposition possède des airs de parenté avec les Droits Communs du travail, mais elle est en réalité beaucoup moins ambitieuse. En effet, seuls les salariés pourraient en bénéficier, puisque le « DIC » est attaché à ce statut et les personnes seraient obligées de puiser dans leur Droit à la Formation pour le « convertir » en Droit à la Contribution, ce qui réduirait sévèrement l’impact du dispositif en terme de capacitation individuelle. Par ailleurs, le système ne marcherait que « dans un seul sens » – de l’emploi vers les activités contributives – et pas dans l’autre : exercer des activités contributives n’ouvrirait pas en tant que tel le bénéfice de droits sociaux pouvant être exercés, par exemple, pour faciliter un retour à l’emploi. Il reste donc dans cette proposition une forme de hiérarchisation entre les différents types de travail, alors que son effacement constitue le principal mérite des propositions d’Alain Supiot.
En janvier 2016, le Conseil National du Numérique a remis à son tour un rapport « Travail, Emploi, Numérique : les nouvelles trajectoires » qui contenait également des allusions au « droit à la contribution ». Il proposait notamment de lier celui-ci au Compte Personnel d’Activité (CPA) mis en place par la loi El-Khomri. Dans le rapport du CNNum, le Droit à la Contribution est pensé comme un mode particulier d’exercice du Droit à la Formation :
Intégrer dans le droit à la contribution, un droit à se former “hors contexte”, en participant à des projets extérieurs au travail quotidien qui contribuent au développement des compétences (participation à un projet d’entreprise, de recherche, d’innovation sociale, apprentissage citoyen). Le compte personnel de formation pourrait être mobilisé et ce droit pourrait être intégré aux plans de mobilité interne des carrières des employeurs.
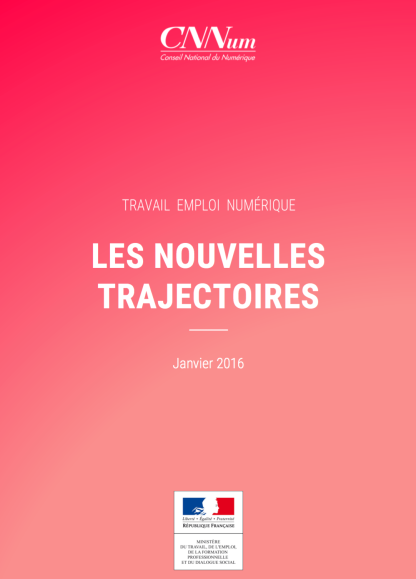
On constate que ces propositions présentent le même biais que celles du rapport Lemoine, puisque ce droit à la contribution/formation n’est pensé qu’en lien avec l’exercice d’une activité salariée. Par contre, le CNNum a une approche moins « unidirectionnelle », puisqu’il envisage que les activités contributives (plus exactement les « activités vectrices d’externalités sociales, environnementales, économiques, alors même qu’elles se déploient dans le cadre non marchand« ) puissent ouvrir le bénéfice de « droits sociaux » :
Imaginer des dispositifs pour ces activités de générer des droits sociaux (formation, ou autres).
Finalement, il n’est presque rien resté de ces propositions dans la loi El-Khomri, sinon quelques traces lointaines, comme la prise en compte dans le cadre du Compte Personnel d’Activité (CPA) des « engagements citoyens » (qui ouvrent des droits – très limités – à la formation).
Enfin, il est difficile de ne pas rapprocher les « droits de tirage sociaux » et les « Droits Communs du Travail » des propositions de « revenu contributif » avancées depuis plusieurs années par Bernard Stiegler. On peut commencer par remarquer qu’Alain Supiot et Bernard Stiegler partagent une conception relativement proche du travail lui-même, notamment en ce qu’ils opèrent une distinction nette entre l’emploi et le travail, qui sert de point de départ à leurs réflexions. Ils appellent également tous deux à reconnaître comme du travail des activités utiles s’exerçant dans un cadre non-marchand, en dehors de l’emploi et du travail indépendant.

Chez Stiegler, les conséquences tirées de ces prémices vont cependant plus loin, car il s’agit pour lui de refondre complètement le système pour promouvoir des « activités contributives » liées à l’acquisition et à la mise en oeuvre de connaissances (savoir-faire, savoir-vivre, savoirs conceptuels). Pour ce faire, Stiegler préconise la mise en place d’un revenu de base complété par un « revenu contributif », conçu sur le mode du régime des intermittents du spectacle. L’idée est de permettre aux individus de pouvoir bénéficier d’un revenu pour dégager du temps afin de développer leurs connaissances et leurs talents. Ce droit à un revenu devrait être périodiquement « rechargé » en exerçant des activités salariées à durée déterminée dans le cadre de « projets contributifs », pouvant être proposés par des entreprises ou par des collectivités publiques. C’est d’ailleurs une formule que Stiegler est en train de tester dans le cadre d’une expérimentation conduite sur le territoire de Plaine Commune.
Il est parfois assez difficile de comprendre en quoi les propositions de Stiegler correspondent à une généralisation du régime des intermittents, car il ne s’inspire que de manière « métaphorique » de ce dispositif (voir la vidéo ci-dessous à partir de 38mn). Les choses s’éclairent cependant si l’on considère qu’il préconise en réalité la création d’un droit au revenu pensé comme un « droit de tirage social ». Mais là où dans les propositions de Supiot, les droits de tirage sont activés occasionnellement par les individus dans des moments de réorientation professionnelle, Stiegler inverse le paradigme et c’est au contraire l’emploi qui est « réactivé » occasionnellement pour recharger un droit au revenu lié à l’exercice d’activités s’exerçant principalement dans la sphère non-marchande. Le retour ponctuel à l’emploi, par les entreprises ou par les collectivités, sert en définitive à « valider socialement » le processus d’acquisition et de développement des connaissances des individus, tout en rassemblant les moyens nécessaires à leur mobilisation dans le cadre de projets.
Le revenu contributif de Stiegler paraît cependant compatible avec les « Droits Communs du Travail » des Économistes Atterrés, puisque ces derniers admettent, comme on l’a vu plus haut, que ces droits puissent inclure « le droit à l’accès à du revenu pour des activités non salariées, mais reconnues d’utilité sociale » ou que les collectivités locales puissent participer au financement d’activités contributives « à partir de dotations des municipalités […] au regard des services rendus« .
Sortir des contradictions d’une « Économie des Communs » sans droits sociaux
L’immense mérite des propositions examinées ci-dessus tient au fait qu’elles élargissent et renouvellent les réflexions autour du modèle économique des Communs, en montrant la nécessité de les compléter par une prise en compte de la question des droits sociaux et de la protection sociale. Une « Économie des Communs » existe déjà, mais plusieurs voix se sont élevées pour en montrer le caractère très imparfait. Michel Bauwens, par exemple, souligne bien le paradoxe dans lequel nous nous trouvons actuellement, en prenant pour exemple le logiciel libre. Il s’agit du secteur où l’Économie des Communs est sans doute la mieux installée, mais si les individus y font vivre des Communs par leurs contributions, rares encore sont les Communs qui contribuent en retour à faire vivre des individus :
[…] une personne qui contribue aux communs ne peut pas dans l’état actuel des choses assurer sa subsistance à travers cette pratique, pour « vivre dans les communs ». Elle doit rester le salarié d’une entreprise, comme IBM par exemple ou une autre compagnie dont le but reste le profit. La valeur est donc « aspirée » en dehors du commun vers la sphère de l’accumulation capitalistique. Et je pense que c’est un phénomène sur lequel nous devons travailler.
[…] certes nous avons des communs, mais il n’est pas possible de « vivre dans les communs ». La seule manière d’assurer sa subsistance, c’est de participer par ailleurs à l’accumulation du capital […] Les gens qui contribuent aux communs devraient pouvoir en vivre et la valeur ainsi produite devrait rester dans cette sphère. Et nous pourrions ainsi nous réinvestir dans les communs, à partir d’une infrastructure dédiée. Cette accumulation dans les communs permettrait en définitive une auto-reproduction indépendante, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Dans le cas du logiciel libre, les individus-contributeurs se retrouvent « écartelés » entre deux situations également inconfortables. Il s’agit en effet soit de bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour participer aux projets, soit d’employés rémunérés par de grandes entreprises pour développer des ressources libres réutilisées ensuite dans le cadre de leurs activités (c’est le cas à plus de 75% aujourd’hui pour Linux).
Or dans ces deux hypothèses, la situation peut être considérée comme insatisfaisante du point de vue de la justice sociale. Le temps libre constitue en effet une des choses les plus inégalitairement réparties dans nos sociétés, ce qui crée une véritable « barrière invisible » à l’exercice des activités contributives en fonction du statut social des personnes. De plus, demander aux individus de contribuer aux Communs en plus de leur emploi principal revient à faire peser sur eux une charge écrasante, alors même que les ressources partagées produisent des externalités positives bénéficiant à toute la société. A l’inverse, les contributeurs salariés par des entreprises reçoivent certes une rémunération liée à leur activité, mais il y a un lourd prix à payer en contrepartie, comme l’a très bien montré Sébastien Broca dans son ouvrage « Utopie du logiciel libre ».
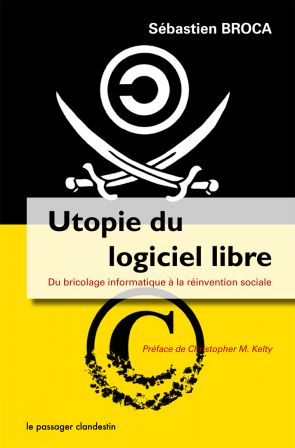
Car il ne faut pas perdre de vue que les Communs sont aussi porteurs d’un idéal d’émancipation lié à de nouvelles formes d’organisation des activités productives. Il n’y a de Communs véritables que là où des communautés peuvent « s’auto-organiser » entre pairs pour prendre en charge la production de ressources partagées, sur la base d’une gouvernance démocratique. Lorsque des Communs – comme c’est le cas pour Linux aujourd’hui – deviennent à ce point dépendants du travail salarié, on peut se demander quel est l’apport réel en termes d’émancipation pour les personnes qui y contribuent. L’activité contributive est alors « ré-encastrée » dans la relation de subordination qui caractérise le travail salarié et c’est son sens profond qui s’en trouve altéré.
S’il existe une « Tragédie des Communs » aujourd’hui, elle est moins liée à l’épuisement des ressources qu’à l’épuisement des individus eux-mêmes, du fait de l’absence de reconnaissance sociale de la valeur de leurs contributions. Même dans le secteur du logiciel libre, la contribution en retour des entreprises reste en réalité insuffisante par rapport à la charge qui pèse sur les infrastructures et c’est souvent dans un grand dénuement que des personnes consacrent leur temps et leur énergie à la production de ces Communs numériques. Une approche par les droits sociaux pourrait contribuer à dépasser ces limites inhérentes à une pensée qui s’est focalisée sur la question des modèles économiques (trouver une interface avec le marché), sans conduire l’indispensable réflexion complémentaire à propos d’un système de protection sociale intégrant la question des Communs.
Renouer avec le sens originel des Communs
On parle de plus en plus d’un « retour » ou d’une « renaissance » des Communs. C’est un phénomène réel, mais il ne s’agit nullement d’un retour à l’identique, car la signification sociale des Communs s’est profondément modifiée par rapport à ce qu’ils ont pu représenter dans les temps passés pour les individus.
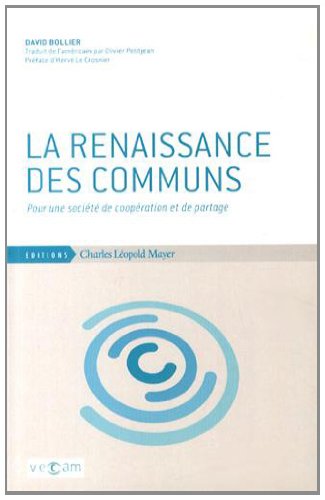
A l’époque médiévale et sous l’Ancien Régime, les Communs existaient en effet avant tout pour assurer la subsistance des membres de communautés paysannes. Les « Communaux » correspondaient alors à des modes de gestion de biens fonciers (pâturages, champs, forêts, etc.) sur lesquels les individus exerçaient des droits d’accès et de prélèvement afin d’en tirer des ressources nécessaires à la satisfaction de leurs besoins de base (du bois pour se chauffer et construire leurs habitations ; des fruits, des champignons, du petit gibier, du miel pour se nourrir, etc.). Des droits collectifs d’usage (vaine pâture, panage) garantissaient que même les membres les plus pauvres de la communauté ne possédant pas de terre restaient en mesure de faire paître quelques bêtes. Par ailleurs, c’est aussi au nom du « droit à la vie » que des droits comme le glanage ou le grappillage venaient limiter la propriété privée en assurant que les plus démunis puissent trouver de quoi vivre. On peut donc considérer que les Communs anciens constituaient une forme de « protection sociale » pour les membres des communautés villageoises et ils n’étaient pas si éloignés non plus d’un revenu d’existence versé en nature. Ces droits coutumiers garantissaient de surcroît une certaine indépendance des personnes, car leur subsistance étant assurée par ce biais, elles n’étaient pas obligées d’aller vendre leur force de travail pour vivre.
Lorsque Elinor Ostrom a redécouvert la question des Communs à partir des années 60, elle a essentiellement étudié des « Communs de subsistance » (systèmes d’irrigation, pêcheries, forêts, etc.) assurant la satisfaction de besoins vitaux pour les communautés les prenant en charge et situés principalement dans des pays du Sud. Pourtant, une sorte de « coupure » s’est ensuite opérée par rapport à cette histoire longue et elle se manifeste aujourd’hui dans la manière dont nous concevons les Communs dans les pays du Nord. Le lien qui avait toujours rattaché les Communs à l’entretien des conditions de vie s’est comme rompu et ce n’est absolument pas anodin.
La raison principale de cette déperdition de sens est à rechercher du côté d’une articulation défectueuse entre le travail et les Communs. Pour des raisons idéologiques et de contrôle social, le système politico-économique dominant a intérêt à « invisibiliser » les formes de contribution non-marchande, en faisant tout pour que les individus qui s’y consacrent ne les envisagent pas comme un travail. Si au contraire, les activités contributives étaient repensées à travers la catégorie du travail, il deviendrait possible de revendiquer le bénéfice d’une nouvelle forme de réciprocité pour les commoners. Nous ne chercherions pas uniquement à trouver des modèles économiques, impliquant un retour financier de la part du marché, mais nous demanderions l’instauration de nouveaux droits sociaux, « validant » collectivement l’accomplissement de ces activités utiles au titre du principe de solidarité. Nous nous autoriserions à penser une réciprocité sociale pour les Communs, au-delà de la seule réciprocité économique.
***
Les Communs commencent à avoir une doctrine économique, mais ils sont encore loin d’avoir complètement compris l’enjeu de se doter d’une doctrine sociale. Pour commencer à la forger, il importe de s’inscrire dans les pas de ceux qui, comme Alain Supiot ou Bernard Stiegler, commencent par opérer une distinction entre le travail et l’emploi pour en tirer les conséquences logiques en matière de refonte du système de protection sociale. C’est un préalable indispensable pour envisager, comme le font les Économistes Attérés, de nouveaux « droits de tirage sociaux » élargis à des « Droits Communs du travail » qui intègrent la problématique de la contribution aux Communs.
Si j’avais pu aller aux ROUMICS, j’aurai essayé de porter ce message : nous pourrons « Vivre des Communs » le jour où sera consacré un « droit au travail dans les Communs ».
A reblogué ceci sur Curation exclusivement en français.
La réflexion très intéressante que vous proposez dans cet article pourrait inclure les travaux de Bernard Friot. Economiste, historien de la sécurité sociale et promoteur d’un salaire à vie déconnecté du marché de l’emploi, il a pu faire la démonstration de la portée révolutionnaire des institutions articulées à la Sécurité Sociale.
La prémisse en étant la déconstruction de la fable du compromis social issu du fordisme qui est la version officielle de l’histoire par la classe dominante mais pas sa réalité documentée.
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit d’établir des passerelles entre un passé et un présent communiste et l’élaboration de communs qui viendrait combler en l’enrichissant « l’articulation défectueuse entre le travail et les Communs ». En vous paraphrasant, on pourrait écrire : Pour des raisons idéologiques et de contrôle social, le système politico-économique dominant a intérêt à « invisibiliser » la portée anticapitaliste de la Sécurité Sociale, en faisant tout pour que les individus qui y contribuent par la cotisation l’envisage comme un système de charité prélevée sur la production plutôt qu’une production commune. »
Une rencontre a déjà eu lieu entre Michel Bauwens et Bernard Friot : https://www.youtube.com/watch?v=N6gS5tFiUGQ
Merci pour ce lien. Le débat entre Bauwens et Friot est extrêmement intéressant. Les activités contributives s’intègreraient en effet autrement dans un système comme celui du salaire à vie. Bernard Friot explique en effet que l’individu serait tout de même encore soumis à des formes de validation sociale, notamment pour établir son niveau de qualification ouvrant droit à tel ou tel montant de salaire. Cette évaluation pourrait prendre la forme d’examens, mais il indique aussi qu’elle pourrait comporter une prise en compte des réalisations effectuées par l’individu. C’est là, j’imagine, que pourraient être mise en avant les activités contributives réalisées sur une période donnée.
TL;DR:
Le Jugement Majoritaire est ce qu’on a de mieux en théorie et en pratique
pour mesurer un niveau de « validation sociale ».
La comptabilité n’est pas neutre, elle est même de plus en plus
biaisée vers les besoins des investisseur·euses capitalistes.
Faire des chambres de compensation locales permet de créer
et contrôler de la valeur économique.
« l’individu serait tout de même encore soumis à des formes de validation sociale,
notamment pour établir son niveau de qualification ouvrant droit à tel ou tel montant de salaire. »
Oui, la définition des critères déterminant le niveau qualification-salaire de chacun·e
(diplômes, ancienneté, pénibilité, utilité, …)
deviendrait l’enjeu principal de la lutte des classes sociales,
car définissant dans quelle mesure telle ou telle activité est un travail ou non,
c’est-à-dire plus ou moins reconnue par l’objectivation
de la violence sociale qu’est la valeur-économique.
Toutefois, faire d’environ 4 niveaux de qualification-salaires un mécanisme d’expression
de la lutte entre environ 4 classes sociales ne va pas non plus de soi.
Et par exemple, au sein du Réseau Salariat (soutenant Bernard Friot),
d’autres économistes comme Christine Jakse défendent davantage l’idée
d’avoir un même salaire pour tous·tes mais de chercher plutôt
des mécanismes de lutte des classes du côté de l’investissement :
où se décide très fortement et globalement
à quelles valeurs-d’usage (activités, projets, recherches, …)
attribuer plus ou moins de valeur-économique.
Mécanismes accaparés à ce jour par les investisseur·euses capitalistes
ou les appareils d’État aux mains de leurs fondé·es de pouvoir.
D’un côté la qualification-salaire évalue des passés individuels,
de l’autre l’investissement évalue des futurs collectifs.
Dans tous les cas, cela implique me semble-t-il de se saisir des problématiques
de souveraineté démocratique sur nos monnaies,
et d’exigence démocratique dans nos caisses/communes de salaire, d’investissements et de gratuité.
Une piste pourrait être de s’inspirer des chambres de compensation locales,
étudiées notamment par Bernard Lietaer ou Wojtek Kalinowski,
qui opèrent des monnaies communes régionales et peuvent même
créer ex-nihilo de la valeur-économique, comme le WIR en Suisse
et peut-être un jour la Sonantes à Nantes.
– « People Money »
https://www.scribd.com/document/312730446/Bernard-Lietaer-People-Money-PDF-From-Epub
– « Le WIR en Suisse : la révolte du puissant ? »
https://regulation.revues.org/11463
Quelles que soit les institutions, la résolution de nos désaccords
sur les critères de qualification-salaire, d’investissement ou de gratuité
est un mécanisme de première importance,
qui nécessite non seulement des écoles, des médias et des infrastructures favorisant
l’esprit critique et des décisions individuelles informées.
– « Moglen à Re:Publica : défendre notre liberté de penser exige des médias libres »
https://benjamin.sonntag.fr/Moglen-a-Re-Publica-defendre-notre-liberte-de-penser-exige
– « Projet pour une presse libre.
Soustraire les médias à l’emprise de l’argent et de l’Etat
en créant un service mutualisé »
https://www.monde-diplomatique.fr/2014/12/RIMBERT/51030
Mais aussi que le pouvoir sur les décisions soit fondé
sur une mesure nuancée et suivie des opinions
de toutes les personnes affectées par telle ou telle décision.
Une mesure agrégée de manière aussi représentative, transparente et résistante
aux manipulations que possible.
Comme le permet le Jugement Majoritaire étudié par Michel Balinski et Rida Laraki.
– « Vous reprendrez bien un peu de démocratie ? Une introduction au Jugement Majoritaire en BD »
https://lechoixcommun.fr/articles/Vous_reprendrez_bien_un_peu_de_democratie-1.html
Et comme ne le permettent ni le scrutin uninominal à deux tours,
ni les « consensus implicites » où « qui ne dit rien consent »
qu’il soit un consensus de riches comme dans les normes ISO ou à l’OMC,
ou un consensus de militant·tes alters.
– « La jungle des normes ISO »
https://www.nolimitsecu.fr/la-jungle-des-normes-iso/
– « Après Cancun… »
http://dsedh.free.fr/transcriptions/Jennar60.htm
Car, comme le font remarquer très à propos les slogans
de sensibilisation contre le viol :
« Qui ne dit pas oui, ne consent pas ».
Dès qu’on veut une « validation sociale »,
le choix du mode de scrutin — l’algorithme d’agrégation sociale —
détermine fortement — non seulement les résultats,
les stratégies, les tactiques et modes d’organisation —
mais avant tout et surtout notre niveau d’obéissance aux résultats,
dans la mesure où cet algorithme participe
à la fabrication de notre consentement.
Henri Guillemin « rappelle » par exemple comment Adolphe Thiers
— l’équarrisseur de la Commune de Paris puis président de la III° République —
s’appuyait sur les précédents de la « Chambre introuvable » en 1815
puis de la « Chambre retrouvée » en 1824 —
pour convaincre ses camarades de classe de remplacer la volonté royale-divine
par une « volonté nationale » plus difficile à critiquer.
Mais une « volonté nationale » sciemment ingénierée pour s’aligner avec les intérêts
des « honnêtes gens », ces « gens de bien » qui ont… du bien ;
et instaureront ainsi des Républiques bourgeoises falacieuses,
pour rendre encore plus résilient et hégémonique leur pouvoir.
– « La Commune de Paris »
https://www.rts.ch/archives/dossiers/henri-guillemin/3477764-la-commune-de-paris.html
Ainsi jusqu’à nos jours où les Pinçon-Charlot
et même très récemment encore les Paradise Papers
— où l’on voit à quel point l’évasion-fiscale/sécession-des-riches est légale —
montrent que « la loi » est en fait « leur loi »
— aux membres de la classe capitaliste.
– « Tentative d’évasion (fiscale) »
http://www.editions-zones.fr/IMG/html/tentative.html
De même Bernard Colasse montre que « la comptabilité »
est en fait « leur comptabilité » — aux investisseur·euses capitalistes.
Qui, en nous imposant une comptabilité
répondant à leurs besoins d’information et de contrôle
— en nous imposant leurs normes, leurs audits, et leurs pratiques sociales et organisationnelles
— en favorisant même leurs dividendes jusqu’à comptabiliser
à leur avantage des gains futurs très incertains
(cf. le combat entre la méthode dite des « coûts historiques »
et la soi-disante « fair value » indexée sur des marchés).
Que notamment par la comptabilité donc,
les investisseur·euses capitalistes s’accaparent aujourd’hui l’économie,
et donc nos existences mêmes.
– « Les fondements de la comptabilité »
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Les_fondements_de_la_comptabilit____-9782707173102.html
Sur cette problématique comptable Bernard Friot « rappelle »
par exemple que la Comptabilité nationale
n’a pas toujours inclus les administrations publiques
et de Sécurité sociale dans le calcul du PIB.
Et donc reconnu — comptablement du moins — les activités
des fonctionnaires/parents/retraité·es/soignant·tes/chômeur·reuses
comme un travail productif et non une « dépense publique » ou une « charge sociale ».
Ces personnes n’étant donc pas plus « à la charge » d’autrui
que les employé·es du travail capitaliste.
Une prise en compte qui ne fut toutefois pas à priori dans le but
de promouvoir une quelconque définition fiscaliste ou salariale du travail
— s’opposant à l’emploi, définition capitaliste du travail —
mais simplement parce que ne pas la faire faussait
les comparaisons internationales avec les pays davantage capitalistes…
On voit bien avec cet exemple qu’en fonction du choix
de ce qui compte et des règles de calcul,
ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont reconnues
comme les plus productives ou les plus consommatrices.
Comme insistait Michel Clouscard en montrant
qu’il n’y a pas de « société de consommation »
— concept laissant entendre que tout le monde consomme autant —
mais seulement des classes sociales qui consomment plus que d’autres.
Pas assez d’intellectuel·les (au sens de Noam Chomsky de « personnes médiatisées »)
ne se saissisent de ces problématiques techniques, mais hautement politiques
que sont les mode de scrutin, les comptabilités, les monnaies.
Même le Monde diplomatique ne connait pas le Jugement Majoritaire
et promeut des scrutins à base de notes, difficilement interprétables et fortement manipulables
— enfin, je leur ai signalé le mois dernier, donc on verra bien à l’avenir.
– « [Le jugement majoritaire] utilise un langage commun pour… »
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/11/A/58089
http://autogeree.net/~julm/monde-diplo.jugement_majoritaire.2017-09-27.txt
Car, lorsqu’on ignore la technique, on gobe facilement la propagande,
puis la tousse sur autrui…
Encore merci Calimaq pour ce billet, et à tous·tes pour vos commentaires 🙂
Pour appuyer les propos de Max B, « le salaire à vie », que défend Bernard Friot est inséparable de la copropriété d’usage de tous les outils de travail par les travailleurs et donc de la maîtrise par eux de l’investissement. C’est, il me semble, sur ce point que sa pensée dépasse la conception marchande des « activités contributives » de Bernard Stiegler.
Dans le système de Stiegler, comme dans celui du Compte personnel d’activité, c’est la performance dans l’emploi (ou dans la valeur intellectuelle, la performance intellectuelle) qui alimente le compte.
Là ou Stiegler adapte son modèle à la précarité, Friot, plus révolutionnaire, accompagne le sien de la suppression de la propriété lucrative. La pensée de Friot est une bonne base pour doter les Communs d’une doctrine sociale.
Je pense qu’on peut aussi très facilement expliquer tous les problèmes et paradoxes liés aux soi-disant « communs » modernes par le fait qu’ils ne correspondent justement pas à la définition d’un « communs ». Je ne sais pas qui, à quel moment, a décidé qu’on allait appeler ça des « communs », alors qu’ils n’ont jamais été réellement pensés ni fondés comme tels (c’est de façon criante le cas du logiciel libre, dont les 4 libertés fondatrices n’ont pas grand-chose à voir avec la philosophie des communs). Disons que tout serait plus simple si on posait la question dans ses termes réels, à savoir : comment faire de ces initiatives diverses et variées (qui ne sont pas encore tout à fait des communs) des communs pour de vrai? Répondre à cette question, c’est répondre automatiquement à la question du financement ET de la gouvernance. Je ne crois pas que « la signification sociale des Communs s’est profondément modifiée », mais plutôt qu’on a utilisé ce terme un peu trop vite, pour désigner des choses qui n’en avaient que quelques aspects, et pas forcément les plus pertinents.
Ce droit au travail dans les communs est à la fois une bonne piste et un piège, puisque ça ne repose pas la question fondamentale : qu’est-ce que les communs? À l’heure actuelle, le logiciel libre n’est pas un « communs » selon moi, et il est hors de question en tant que citoyenne que je contribue au droit de quiconque d’aller travailler dans n’importe quelle bêtise qui se revendiquera du logiciel libre (ce n’est qu’un exemple)… Là, je me réfère à votre paragraphe : « Car il ne faut pas perdre de vue que les Communs sont aussi porteurs d’un idéal… » Je suis en accord complet, mais j’aimerais ajouter que ce n’est pas seulement la dépendance à un travail salarié qui fait obstacle à cet idéal, mais aussi le fait qu’actuellement, trop de ces projets sortent totalement du contrôle et de la concertation de/avec la communauté. Juste parce que c’est du logiciel libre n’en fait pas automatiquement (et loin de là!) quelque chose « d’utilité sociale ». Demain, je code une app libre pour permettre de harceler vos victimes plus efficacement; c’est l’inverse de l’utilité sociale, et pourtant, tant que je me plie aux 4 libertés… mon projet ferait partie des communs et je pourrais prétendre à une valorisation sociale à ce seul titre? Vous voyez le problème. (Et je ne crois pas non plus à une définition objective possible, ie inscrite dans la loi, de ce qui est « d’utilité sociale »; c’est le fait que la communauté soit impliquée dans la décision qui valide l’utilité sociale ou non d’un projet. Or, dans le logiciel libre, rien n’oblige actuellement de consulter la communauté en rien.)
En fait, plus ça va, et plus je suis persuadée que *tous* les problèmes du logiciel libre (et le financement n’est pas le seul; on pourrait aussi mettre en question son incapacité globale, sauf exceptions, à être adopté par les « masses », la difficulté des projets à se pérenniser, etc.) sont liés à ses inadéquations au regard des exigences d’un « communs ». Devenir un communs, assumer pleinement ce statut et ses conditions, règlerait tout, absolument tout. Mais tant qu’on fera semblant que c’est déjà le cas, que le logiciel libre *est* actuellement un communs, alors on sera dans l’impasse… Réduits à bricoler des arrangements aussi complexes que branlants.
Cela dit, toute la réflexion sur le travail vs emploi et les droits sociaux qui y sont liés est très intéressante et instructive par ailleurs.
Bonjour,
Merci pour cet intéressant commentaire. Le logiciel libre n’est pas en lui-même un Commun, car il recouvre un ensemble de pratiques sociales extrêmement variées.
Mais il est clair que certains logiciels, ou plus exactement certaines communautés qui développent des logiciels libres, se sont structurées comme des Communs.
Cet article fait très bien le tour de la question, avec de nombreux exemples https://framablog.org/2017/09/29/le-logiciel-libre-est-il-un-commun/
Si l’on prend le cas de Debian ou de Wikipedia (si on élargit en dehors du logiciel), on voit qu’on est bien face à des pratiques qui correspondent aux trois critères de définition des Communs.
Le rapport entre les Communs et les logiciels libres est donc complexe, mais c’est aussi ce qui fait de la notion de Communs quelque chose d’intéressant, car c’est un outil d’examen critique des pratiques sociales.
Tout a fait d’accord avec Silren et MaxB, l’émancipation par la sortie d’un système capitaliste. Le revenu de base est une erreur absolu car il ne s’attaque pas aux problèmes créés par le système capitaliste mais le servira toujours. Les communs c’est aussi la terre, l’air, l’eau, allez demander aux capitalistes de respecter la planète !? COP combien déjà ?